Deuxième moitié.
Le milieu du chapitre VII est un tournant. Car voilà qu’après avoir étudié le comportement du mauvais côté, revient l’autre côté, que l’on croyait perdu à tout jamais, réduit en bouillie sur le champ de bataille. On apprendra plus tard son histoire : il a en réalité été récupéré par une confrérie secrète, rafistolé, et renvoyé au pays.
Le narrateur ne comprend pas tout de suite à qui il a affaire. D’une certaine manière, lorsqu’on est habitué au mal, le moment où le bien surgit paraît suspect. Il y a nécessité d’une période de désaccoutumance avant de pouvoir à nouveau voir le bien, et l’intégrer dans la vie.
Le narrateur est endormi. Une araignée venimeuse essaye de le piquer, mais le vicomte l’en empêche et l’araignée lui pique la main, son unique, la gauche.
Le narrateur se réveille.
« « Tu es mon neveu, dit Médard.
– Oui, lui répondis-je, un peu surpris parce que c’était la première fois qu’il le disait.
– Je t’ai reconnu tout de suite « , déclara-t-il. »
Premier doute.
« Mais il vaut certainement mieux que ce soit ma main plutôt que le cou de cet enfant.
Mon oncle, que je sache, n’avait jamais parlé ainsi. »
Deuxième doute.
« L’idée qu’il pouvait dire la vérité et être brusquement devenu bon me traversa l’esprit ; mais je la chassai tout de suite. C’était chose habituelle chez lui que le piège de la simulation. […] Il semblait bien changé : avec une expression non plus cruelle et tendue mais languissante et triste |…] Ses vêtements étaient poussiéreux et d’une forme un peu différente de ses vêtements habituels, son manteau noir était légèrement déchiré avec des feuilles sèches et des bogues de châtaigne accrochés aux pans. Son costume même n’était pas en velours noir comme d’habitude ; c’était un costume de bure râpé et déteint ; sa jambe n’était pas gainée d’une haute botte de cuir mais couverte d’un bas de laine rayé bleu et blanc. »
Troisième doute.
Mais la description tout en contraste n’en laisse que peu au lecteur sur la nature de cette nouvelle moitié. Le costume de bure rappelle la tenue des franciscains, qui avaient fait de pauvreté complète, ce qui prolonge l’image des feuilles et des bogues collés au manteau. Le mauvais vicomte règne sur le château, le bon gambade dans la nature et dort à la belle étoile. Pour peu, on s’attendrait à ce que le conte redevienne manichéen. Il n’en est rien. Car comme le mauvais côté contenait encore quelque chose de bon, le bon est tellement bon que, dans notre monde, il en paraît étrange.
Le narrateur, qui voulait pêcher des anguilles, avait installé une canne à pêche. A la place de l’hameçon, il trouve une bague en or, laissée par le vicomte. Celui-ci s’en explique :
« En passant par ici j’ai vu une anguille prise à l’hameçon ; elle m’a fait tant de peine que je l’ai délivrée. Ensuite, pensant au préjudice que mon geste allait porter au pêcheur, j’ai voulu le dédommager en mettant à sa place ma bague, la dernière chose de valeur qui me restât. »
On voit aussitôt qu’il y a quelque chose de déséquilibré : dans l’esprit du vicomte, la compensation pour une anguille, c’est une bague de famille en or ? Qui plus est une bague à la valeur sentimentale infinie, puisque c’est la dernière chose qui lui reste ? Absurde.
Ne comprenant pas le sens de ce revirement, le narrateur s’enfuit aussitôt chez la nourrice, qui veut préparer un onguent pour soigner la main blessée du vicomte. Le narrateur dit qu’il s’agit de la gauche, la nourrice se moque : « Tu ne reconnais plus ta droite de ta gauche, maintenant ? » Rappel du thème de la confusion du bien et du mal, dont le mélange est notre lot métaphysique.
De retour dans la clairière où il s’était endormi, le narrateur tombe sur le mauvais côté, qui lui joue à nouveau un vilain tour en l’envoyant dans un guêpier. Le narrateur est presque soulagé : les choses reviennent à leur place. Mais c’est tout temporaire, parce que cette épidémie de bien se propage : toute la région peut bientôt constater les bonnes actions de Médard.
Mieux : il semble vouloir corriger certains actes passés.
« Depuis longtemps l’arbalète du vicomte ne frappait plus que les hirondelles. Et de façon non pas à les tuer, mais à les blesser et à les estropier. Or, maintenant, on commençait à voir dans le ciel des hirondelles aux pattes bandées consolidées par deux éclisses, des hirondelles aux ailes recollées et couvertes d’emplâtres. Il y avait tout une bande d’hirondelles ainsi harnachées qui volaient prudemment toutes ensembles et l’on disait, non sans invraisemblance, que c’était Médard même leur docteur. »
Calvino utilise ici un thème central de la kabbale : celui de la réparation.
La question est la suivante : si Dieu est Dieu, comment se fait-il que le monde soit dans l’état que nous connaissons ? Autrement dit : pourquoi y a-t-il un si grand écart entre le monde tel qu’il est et le monde tel qu’il devrait être ?
Pour la tradition juive, la réponse est simple : parce que c’est à l’homme de l’achever. C’est à l’homme de participer au projet du créateur en le perfectionnant. Le monde a en quelque sorte été brisé en passant de l’idéal à la réalité : le rabbin Isaac Louria (XVIème siècle) explique qu’il s’agit maintenant de le réparer. C’est la tâche de l’être humain : parvenir à achever le projet du créateur, le faire exister tel qu’il doit être, afin de pouvoir passer à l’étape suivante.
Ici, le bon côté de Médard entreprend de réparer ce qu’a causé son autre moitié. Les oiseaux que l’on avait vu au premier chapitre, envoyés par le père depuis la cage, brisés par le mauvais côté de Médard, sont maintenant réparés un à un, et peuvent à nouveau voler : image que le monde n’est pas condamné. Il existe un espoir : celui de la réparation.
Peu de temps après, le bon côté de Médard rencontre Paméla. Ils s’abritent dans une anfractuosité rocheuse lors d’un orage, et voilà que Paméla comprend peu à peu de qui il s’agit.
Arrêtons-nous un instant sur cette image de l’abri dans la roche. On trouve un passage similaire dans le livre de l’Exode (33,20 et suivants). Moïse demande à l’Eternel de lui montrer sa face. Mais l’Eternel lui répond que c’est impossible.
Et les versets 21-22 disent : « L’Eternel ajouta : « Il est une place près de moi : tu te tiendras sur le rocher ; puis, quand passera ma gloire, je te cacherai dans la cavité du roc ». »
Les commentaires expliquent qu’à ce moment-là, Moïse a eu la révélation d’une question métaphysique absolument cruciale. Autrement dit : dans l’anfractuosité de la roche, se joue un moment de dévoilement du sens.
Et c’est exactement ce qu’il se passe dans le récit. Médard explique à Pamela ce qu’il a compris de cette expérience, ce qui constitue en quelque sorte la morale de l’histoire :
« C’est l’avantage d’être pourfendu, que de comprendre dans chaque tête et dans toute chose la peine que chaque être et tout chose ressentent d’être incomplets. J’étais entier, je ne comprenais pas. J’évoluais sourd et incommunicable parmi les douleurs et les blessures semées partout, là même où un être entier ne saurait l’imaginer. Ce n’est pas moi seul, Paméla, qui écartelé et pourfendu, mais toi aussi, nous tous. Et maintenant, je sens une fraternité qu’avant, lorsque j’étais entier, je ne connaissais pas. Une fraternité qui me lie à toutes les mutilations, à toutes les carences du monde. »
Très vite, la renommée du Bon parvient aux huguenots. Ils attendent et voilà que le Médard nouveau arrive grimpé sur un mulet.
L’intertextualité biblique est aussi claire que pleine d’humour : le messie, d’après la tradition juive, doit arriver juché sur un âne. Mais Médard n’est que la moitié de lui-même, il ne peut arriver que sur la moitié d’un âne, autrement dit sur un mulet, croisement d’un âne et d’une jument.
Comme il se doit, il est accueilli par un chant de psaumes, puis s’en suit une discussion théologique qui se termine par de l’eau tiède. Entre un religieux qui a oublié sa religion et un demi-vicomte, il ne pouvait en être autrement.
Le vrai passage intéressant porte sur les prix du seigle. Voyant les prix pratiqués par la communauté, Médard essaye de les faire changer d’avis :
« Mais songez à la charité que vous feriez à ces pauvres gens, si vous baissiez le prix du seigle… Pensez au bien que vous pourriez faire… »
Ce à quoi le vieux Ezéchiel répond, lapidaire : « Faire la charité, mon frère […] ça ne veut pas dire perdre sur les prix. »
A nouveau, l’intertextualité avec la pensée hébraïque est saisissante.
Pour comprendre le fond du dialogue entre Médard et Ezéchiel, il faut se pencher sur une discussion talmudique qui se trouve au début du traité Sanhédrin, à la page 6b.
Là-bas, on demande ce que signifie le verset du deuxième livre de Samuel (8, 15) qui dit « et David fit la justice et la charité à tout son peuple ».
Les deux valeurs semblent en effet en contradiction. La justice, dans ce contexte, consiste à donner à chacun selon son dû, tandis que la charité consiste à donner, même si la personne ne mérite pas. Comment les deux peuvent-ils coexister ?
Le Talmud amène plusieurs opinions qui essayent d’expliquer comment c’était possible. Par exemple, dans le cas où le roi David devait juger une affaire monétaire entre deux parties et que l’une des parties devait de l’argent à l’autre, le roi donnait l’argent à la partie lésée (justice), mais de sa poche à lui (charité vis-à-vis du créditeur).
Quelque chose de similaire se joue entre le bon Médard et Ezéchiel. Médard veut forcer des prix bas sur le seigle : charité. Mais Ezéchiel veut que ce soit le prix réel : justice.
Dit en termes économiques, Médard veut fixer un prix en-dessous du prix d’équilibre ; Ezéchiel lui rappelle qu’il existe une offre, une demande et un prix d’équilibre, et que demander le prix d’équilibre n’est que justice.
L’enjeu aurait été d’arriver à articuler la charité et la justice, à résoudre l’équation entre des prix hauts et des gens qui ont peu de moyen : Médard échoue et prend partie pour l’un des côtés. On ne sera évidemment pas surpris : il n’est que la moitié de lui-même !
Pendant ce temps-là, au château, il y a une intrigue de palais afin de renverser le mauvais côté et de remettre le bon.
Les conjurés vont voir le bon côté du vicomte et proposent de tuer l’autre.
Mais le vicomte est effaré : il refuse tout net. Après tout, c’est de lui qu’il s’agit. Alors les conspirateurs proposent de couper la poire en deux : on ne le tuera pas, mais on l’enfermera dans la tour pour qu’il arrête de nuire et que le bon côté puisse reprendre les commandes. Mais ce dernier refuse à nouveau. Il a une autre stratégie en sa demie-tête :
« Je suis très chagriné de la brutalité du vicomte. Mais il n’y a pas d’autre remède que de lui donner le bon exemple en se montrant à lui aimables et vertueux ».
On a l’impression du raisonnement d’un adolescent qui dirait : « on va faire une bonne action, ça va lui apprendre quelque chose ».
Le diagnostic est un peu court. L’histoire du vingtième siècle nous a montré, fort cruellement, que face au mal, il était nécessaire de se lever le plus tôt possible. Opposer le bien est nécessaire, mais non suffisant : comme un jardin qu’il faut entretenir, il faut à la fois s’occuper des buissons de roses et enlever activement les mauvaises herbes.
Mais dans notre histoire, comment espérer de toute façon que le penchant vers le mal devienne vertueux ? Vœu pieux, de la même manière que lorsque la nourrice espérait qu’il se repente.
Le bon Médard demande aux conjurés qu’on porte un onguent au mauvais : il sait ce que c’est que de n’exister qu’à moitié et que d’avoir une plaie non cicatrisée comme limite. Ce qui devait arriver arrive : le mauvais Médard découvre évidemment la conjuration et fait massacrer tous les conspirateurs.
Le narrateur ajoute que le bon porta des fleurs sur les tombes et qu’il alla ensuite consoler les veuves et les orphelins. Il sait quoi faire une fois que le mal a eu lieu, mais a été complètement impuissant à l’arrêter à la base : éternelle conséquence des bons sentiments.
La seule qui traite les deux pareil, c’est Sébastienne, la nourrice. Elle qui l’a aidé à grandir, sait que cette séparation n’est qu’une optique. Elle les considère toujours unis. Le bon commence à lui rendre visite régulièrement et il s’ensuit alors un dialogue délicieux où elle lui reproche de s’être mal comporté. Le bon proteste : « tu sais bien que ce n’est pas moi ! »
Ce qu’il se joue là, c’est une problématique morale qui est posée par le Rambam dans le Traité des huit chapitres. Dans cet ouvrage, Maïmonide, l’un des grands rabbins du moyen-âge, explique que la morale présuppose l’unité de l’être (chapitre un : « sache que l’être de l’homme est un être un, mais que ses fonctions sont multiples »). Il ne peut y avoir de parties dans l’être humain, parce que si celui-ci était fragmenté, il suffirait toujours de renvoyer la mauvaise action à une autre partie de l’être, innocentant immédiatement les autres. Celui qui a donné une gifle pourrait par exemple immédiatement dire : « ce n’est pas moi, c’est mon bras droit ! » L’unité de l’être est la base de la morale, mais également de la justice : sans cette unité fondamentale du sujet, rien de ce qui découle de ces deux domaines n’a de sens.
Sébastienne, qui visiblement a étudié le Rambam, rappelle continuellement à Médard que le fait d’avoir deux côtés n’est pas une excuse pour justifier n’importe quel comportement, pas plus que le fait que ces deux côtés battent la campagne de façon discrète.
Le bon Médard continue son office. Il se rend chez les lépreux régulièrement : « il ne se proposait pas seulement de soigner les corps des lépreux, mais aussi leur âme. Il était constamment au milieu d’eux à leur faire la morale ; à fourrer le nez dans leurs affaires, à se scandaliser et à prêcher. Les lépreux ne pouvaient pas le souffrir. »
Autrement dit : il commence à pomper l’air à tout le monde, au point que le narrateur écrit : « des deux moitiés, la bonne est pire que la mauvaise. » Et de l’avis général : « heureusement que son boulet de canon ne l’a coupé qu’en deux, disait tout le monde. S’il en avait fait trois morceaux, Dieu sait ce qu’il nous aurait fait voir! »
Le bon Médard essaye même, toujours dans son optique de mettre la charité devant tout, de ruiner les huguenots. Il compte les sacs dans les greniers, les sermonne sur les prix et va ensuite révéler les stocks à tout le monde pour casser leur entreprise.
Cet état de fait a une mauvaise influence sur l’ensemble de la région : « Nos sentiments devenaient incolores et obtus parce que nous nous sentions comme perdus entre une vertu et une perversité également inhumaine.»
Il est temps que l’histoire se termine, et, comme dans tous les contes de fées, elle s’achève par un mariage. Les deux moitiés prennent la même décision : il faut épouser Pamela. Là se trouve le secret de l’unité.
Et les deux ont la même stratégie : Paméla doit épouser l’autre moitié. Paméla a sa propre stratégie et dit aux deux qu’elle va les épouser, et leur donne rendez-vous même lieu, même heure.
Le mauvais est en retard. Le bon épouse Paméla, et voilà que l’autre surgit au fond de l’église. Ils se défient en duel.
S’ensuit une des grandes scènes de duel de la littérature. C’est le combat des deux penchants, l’éternel combat qui existe dans le cœur de chaque homme et dont parlait Soljenitsyne. « C’est ainsi que l’homme se ruait contre lui-même, les deux mains armées d’une épée ».
C’est un combat vain, car les termes sont biaisés : il ne s’agit en aucune manière de détruire l’un des deux. Dans le cas de Médard, les coups ne portent pas. Chaque épée vise précisément le vide de l’autre. « L’infortuné se battait rageusement, férocement ; mais il ne parvenait jamais à toucher là où était son ennemi. Le Bon avait la correcte maestria des manchots, mais il ne faisait que cribler de trous le manteau du vicomte ».
Il n’y a qu’une solution. Dans une embrassade ultime, ils se blessent l’un l’autre, exactement sur la ligne longitudinale. La blessure se réouvre et le docteur s’en occupe immédiatement. Il rafistole les deux Médard, et voilà qu’il ne font plus qu’un à nouveau. Bien et mal, l’un et l’autre, droite et gauche, enfin réunis, enfin rassemblés, et qui sait, peut-être même un jour, réconciliés.
Non seulement ça, mais il est désormais marié à Paméla : une nouvelle unité a été construite.
« C’est ainsi que mon oncle Médard redevint un homme entier, ni méchant ni bon, mélange de bonté et de méchanceté, c’est à dire un être ne différant pas, en apparence, de ce qu’il avait été avant d’être pourfendu. Mais il avait l’expérience de l’une et de l’autre moitié ressoudées : aussi devait-il être sage. »
Il eut une vie heureuse, beaucoup d’enfants, et gouverna avec justice. Et le narrateur de conclure : « mais il est clair qu’il ne suffit pas d’un vicomte complet pour que le monde entier soit complet. »
Ainsi s’achève l’histoire de Médard de Terralba, qui vit ses deux penchants séparés pour l’édification du monde, et qui ne retrouva la vie heureuse qu’après avoir été brisé, pour n’en être que mieux réparé ; ainsi s’achève le Vicomte pourfendu, chef d’œuvre de la littérature, qu’Italo Calvino écrivit à l’âge de vingt-huit ans.
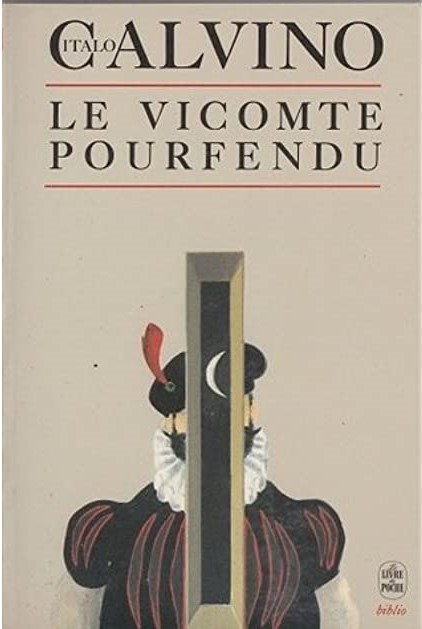
Un avis sur « Italo Kabbaliste (2/2) »
Commentaires fermés